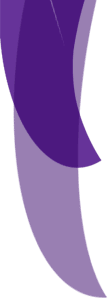Il existe deux événements dans l’histoire de la France qui me
semblent liés, même avec un écart de deux siècles, par un manque d’argent, par la haine d’une « société bloquée »,
par un manque de droits fondamentaux et par l’incapacité de ceux au pouvoir de faire quelque chose pour résoudre leurs
problèmes. Il y a plusieurs parallèles et différences entre ces deux, mais pour comprendre et apprendre de nos erreurs et
les erreurs du gouvernement, il faut se poser la question : quoi a changé ? Avec le recul, y-a-t-il eu un impact
positif sur le pays, ou devrait-on accepter la vérité « plus ça change, plus c’est la même chose », la célèbre
épigramme du philosophe Alphonse Karr en 1849 ?
La Révolution était principalement due à la famine, le manque d’argent
et un ressentiment de l’absolutisme royaliste et de l’ancien régime. Au dix-septième siècle, les États Généraux
du pays s’est composé de trois états : la noblesse, le clergé et le ‘troisième état’, les masses de
la France. Emmanuel-Joseph Sieyès, prêtre et un essayiste célèbre à l’époque, a publié une brochure en janvier 1789
déclarant :
« Qu’est-ce que le troisième état ? Tout. Qu’est-ce
qu’il a été jusqu’ici dans l’ordre politique ? Rien. Qu’est-ce qu’il voulait être ?
Quelque chose »
Les Français ne pouvaient pas se prononcer contre le gouvernement ou
la monarchie sans le risque certain d’être jeté en prison.
Au mi-juillet 1789, les Parisiens étaient déchaînés à cause de l’occupation
militaire allemande et suisse et les nouvelles que le ministère de finance, Jacques Necker, a été viré par la famille royale
après leur avoir suggéré comment mieux utiliser leurs fonds dans ce temps financièrement difficile. Du chaos reignant la capitale
et même aux menaces de mort, les Français n’avaient rien à perdre. La Bastille, un symbole de l’Ancien Régime
et tout qui était détesté par les Français[1], a été prise pour des armes et l’ammunition. Marquis de Launay, le chef de
la Bastille, était tué.
En avançant au vingtième siècle, c’était la frustration des élèves
et leur manque de liberté qui a commencé les grèves de mai ’68. Quand la violence a éclaté au début du mois, environ
soixante-douze policiers et nombreux étudiants ont été blessés et des centaines étaient arrêtés. Les médias étaient étonnés
par la réaction des étudiants – personne ne s’attendait à cette vague de colère intense et de frustration.
Dans les jours suivants, il y avait plusieurs démonstrations par les étudiants
furieux dans les rues et les images sur la télé de la violence étaient horrifiques – des voitures calcinées, de verre
écrasé, des vestiges des barricades. Bien que la Sorbonne était ré-ouverte, la CGT et la CFDT, deux grandes confédérations de syndicats, inspirés par les étudiants, ont déclenchés
les grèves des ouvriers, qui en avaient marre avec leur président et leur faible revenu et qui ont défilés avec les étudiants
en marchant les rues de Paris, criant « Dix ans, ça suffit ! ». Même les politiciens comme le jeune François
Mitterand – un futur président – a appelé pour le changement :
il a déclaré le 13 mai :
« Il est grand temps que le gouvernement s’en aille[2] ».
Les ouvriers ont demandés une augmentation des salaires et une amélioration
des conditions de travail. Le 17 mai, deux cent milles usines étaient en grève en France. Dans les prochaines vingt-quatre
heures, ce chiffre-là augmenterait à deux million.
Le travail a arrêté, des usines étaient en grève, la télévision était
éteinte et le débat aillait bon train – la France est arrivé à une impasse. Le 24 mai, le président Charles de Gaulle
s’est adressé à la nation, mais son message télévisé n’est pas passé ; le public l’a regardé mais il
n’a pas entendu - il était un vieil homme en charge d’un vieil monde. Comme les Français deux siècles auparavant,
« l’ancien régime » des années soixante n’était plus acceptable – les Français voulaient le changer.
Le référendum l’a prouvé et en avril 1969, De Gaulle s’est retiré. Deux ans après, il est mort subitement devant
sa télévision chez lui.
Alors, sont-ils liés d’une manière ? Le manque d’argent
entraîne toujours les problèmes économiques et sociaux ; quand Louis XVI a monté le trône, le pays était au bord de la
faillite, et en ’68, les Français pouvaient beaucoup d’impôts très élevés, mais gagnaient relativement peu.
Dans ces deux époques, l’égalité et des droits fondamentaux étaient
questionnées : les citoyens en avaient ‘ras-le-bol’ de ne pas avoir leur droit de parler et questionner.
A l’usine Renault en ’68, les ouvriers ont chantés pour un ‘gouvernement des peuples’ et les étudiants
des facs ne pouvaient plus supporter d’être traité comme des enfants – il leur semblait qu’ils n’avaient
pas de voix.
Ces deux générations de Français ont vécu une société bloquée :
sous l’ancien régime, tout le monde avait leur place et ils ne pouvaient pas le changer ; sous de Gaulle, des choses
ont été stable (politiquement) – il n’y avait pas d’espace pour l’évolution. Le 15 mars 1968, le journaliste
Pierre Viansson-Ponté a écrit un article dans ‘Le Monde’ dans lequel il a dit que :
« La France souffrait
d’une maladie politique grave – l’ennui »
Les jeunes n’avaient rien à faire, donc ils se sont occupés avec
des moindres préoccupations et les choses qu’ils pouvaient changer - la Révolution sexuelle des années soixante, par
exemple.
Ces deux mouvements ont mené aux changements plus grandes – la Révolution
a changé l’histoire française pour toujours : ils avaient établis une république au lieu d’une monarchie,
le système féodal était abolit, donc les dirigeants des peuples étaient élu plutôt que né avec un titre, et le 26 août 1789,
on a eu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC). Inspirée par la Révolution et débattu par l’Assemblé
Nationale à Versailles, ces règles s’appliquaient à tous, ‘les Français, les étrangères et les ennemis’[3]. La déclaration était si influente
qu’elle a même joué son rôle dans la création de la célèbre Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948
et les lois de plusieurs états modernes. En 1789, la monarchie était détruite, on avait le début d’un nouveau système
de gouvernement, de plus d’égalité et de plus de liberté d’expression.
Pourtant, n’oubliez pas que seulement quinze ans après la Révolution,
Napoléon Bonaparte s’est couronné empereur de la France, re-établissant la monarchie. Aujourd’hui il existe bien
sûr toujours des problèmes en France : en 2007, il y avait environ cent mille SDF[4] (sans domicile fixe), dont quatre-vingt pourcent situées à Paris ; la violence
éclate dans les banlieues, le pire étant en 2005, les trois semaines les plus violentes dans l’histoire du pays depuis
’68.
Donc, quoi a changé ? Est-il mieux maintenant pour les Français ?
Le célèbre magistrat Philippe Bilger se déclare peu enthousiaste :
« A supposer même que pour certains aspects de la vie sociale et familiale, ces événements
aient marqué durablement et profondément notre tissu existentiel … ces tendances ne doivent pas faire oublier la leçon
fondamentale et triste de mai 68 … les adultes, globalement, ont laissé se déliter leur courage, leur capacité d'affrontement.
Ils ont théorisé leur lâcheté. »[5]
Mais il me semble que ceux comme M. Bilger
ont oubliés que depuis ’68, le public a manifesté d’autant plus souvent que dans le passé – maintenant ils
ont dans le sang.
Il y avait certains grands changements positifs - les Français d’aujourd’hui
peuvent maintenant avoir les congés, il n’y a pas autant d’injustice parmi les différentes classes sociales (bien
qu’il y ait encore des problèmes de racisme qui existent) et il y avait une augmentation dans les nombres d’étudiants
qui sont allés à l’université dans le dernier siècle :
« En 1938, la France
avait 60,000 étudiants à l’université. En 1961, elle avait 240,000. Sept ans plus tard, le chiffre est monté en flèche
à 605,000, autant qu’une combinaison de ceux en Grande Bretagne, l’ouest de l’Allemand et la Belgique[6] »
Dès la Révolution et 1968, les gens savent maintenant qu’ils peuvent
changer des choses – s’ils s’engagent avec assez de ruse (en se montrant comme les victimes, par exemple)
et en manifestant sans la violence, leurs buts pourraient être achevés.
« Cette foi, encore, que l’on peut changer les choses. Mai 68 ce sont des débats,
des exigences parfois non préméditées. L’excitation de sentir qu’à ce moment précis quelque chose se passe, que
l’on y participe et que tout est possible[7] ».
Ni une révolte d’étudiants dans un pays n’avait jamais réussi
à renversé un gouvernement, ni une révolte d’ouvriers.[8] Ça c’est largement grâce aux
développements technologiques récents. Il y a deux siècles, les nouvelles n’auraient circulés que par de vive voix,
donc avant que des autres auraient eu l’idée de révolter, tout se serait dissipé il y a longtemps. Les jeunes de ’68
ont emprunté les médias pour avancer et publier leurs manifestations très vite. Là ces deux événements sont arrivés dans les
époques très différentes.
Les jeunes d’aujourd’hui sont médiatiques - ils utilisent
l’internet et les portables pour donner les renseignements comme le collectif indépendant IndyMedia le plus vite possible.
Ces deux événements étaient « des poudrières sociaux qui devraient arriver[9] » Ils devraient arriver, ou les Français seraient encore dans l’âge
des Ténèbres. Avec ces deux événements, on a vu arriver l’égalité, la liberté, les droits des Hommes, le pouvoir de
manifester et l’opportunité de se prononcer contre ceux au pouvoir et de dire ce qu’on a à dire pour le bien-être
de tous :
« Mai 68 est avant tout un évènement … en France, notre histoire est emplie de pavés
: les pavés de la Révolution, les pavés de la Commune, les pavés de Mai 68… Notre histoire, comme un mur où ces pierres
s’empilent et revêtent un caractère sacré[10] ».
Pendant la Terreur après la Révolution, les Français ont guillotinés le roi[11]. En 2009, ils gardent les chefs d’usine en otage. Il y a des choses qui ne
changent jamais, mais c’est clair qu’il y avait des grands changements et désormais, ils ont une voix.
[1] ‘The Day That Made History: The Fall of the Bastille’
Nathaniel Harris, 1986
[2] ‘De Gaulle et mai 68’
http://www.charles-de-gaulle.org/article.php3?id_article=101&page=2
[3] La Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen - Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l'homme_et_du_citoyen_de_1789
[4] Un article détaillé sur les SDF en France par Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sans_domicile_fixe_en_France#Promesse_de_Nicolas_Sarkozy_:_z.C3.A9ro_SDF_en_2008
[5] ‘Mai 68 – Un rêve … et un échec’
Un
article écrit par Philippe Bilger pour Marianne2.fr
http://m.marianne2.fr/index.php?action=article&numero=86733
[6] ‘Egalité! Liberté! Sexualité!’:
Paris, May 1968’
John Lichfield, 23rd February 2008
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/egalit-libert-sexualit-paris-may-1968-784703.html
[7] ‘Sous les paves que reste-t-il?’
Discours
de Julie Trassard
http://mai68sciencespo.blogspot.com/2008/05/discours-de-julie-trassard.html
[8] ‘Egalité! Liberté! Sexualité!’: Paris,
May 1968’
John Lichfield, 23rd February 2008
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/egalit-libert-sexualit-paris-may-1968-784703.html
[9] ‘May 68: France’s
month of Revolution’
Iain Gunn
http://www.marxist.com/1968/may68.html
[10] ‘Sous les paves que reste-t-il?’
Discours
de Julie Trassard
http://mai68sciencespo.blogspot.com/2008/05/discours-de-julie-trassard.html
[11] Reign of Terror - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Reign_of_Terror